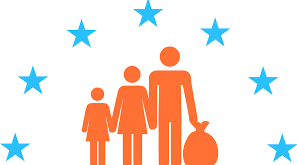Ces dernières années, plusieurs pays européens ont souffert du terrorisme sur leur sol, parfois dans des attaques aux proportions démesurées, qui ont systématiquement fait ressortir le débat sur la réponse pénale à apporter au terrorisme.
Aujourd’hui, l’apparition ou la réapparition dans les pays européens les plus touchés (Turquie, France, Royaume-Uni) de certaines peines considérées comme contraires à l’art. 3 de la Convention ESDH, prohibant les traitements inhumains et dégradants, interroge notre avenir.
A l’heure où une partie de l’opinion publique et des élus demande le retour de la peine de mort ou l’instauration d’une perpétuité incompressible pour les « terroristes », peut-on imaginer pareille résurgence sécuritaire dans le cadre de l’Union et du Conseil de l’Europe ?
Le retour de la peine de mort: un phénomène minoritaire excluant
Force est de constater qu’une exposition à des vagues d’attaques terroristes répétées et meurtrières influe sur l’opinion publique et la parole politique. En France, nombreux furent les parlementaires à demander l’application d’une perpétuité dite réelle ou incompressible à l’endroit des « terroristes », dénomination dangereusement vague sur laquelle il conviendrait d’ailleurs de revenir. Le gouvernement Valls II fut très réceptif au message sécuritaire qu’envoyait le groupe Les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête, aboutissant à l’art. 421-7 du Code pénal.
En Turquie, à la suite des nombreuses attaques et du putsch avorté de 2016, Recep Tayyip Erdogan a quant à lui promis le rétablissement de la peine de mort s’il obtenait une majorité suffisante au Parlement pour modifier la Constitution, où l’abolition se trouve inscrite depuis le 7 mai 2004.
Plus récemment encore, suite à l’attentat qui a ensanglanté la ville de Manchester, ce fût au tour des parlementaires populistes britanniques Paul Nuttall (leader du UKIP) et Janice Atkinson (ex-UKIP) de réclamer le retour de la peine de mort. Le premier a réclamé son rétablissement, signalant sa disponibilité pour procéder lui-même aux exécutions des personnes condamnées pour terrorisme ou infanticide ; la seconde s’est quant à elle prononcée sur la nécessité d’une telle peine… pour les kamikazes. Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra, l’auteur la laisse à la solitude de son choix.
En dehors de toute considération politique, il faut surtout avoir en tête les questions juridiques que soulèverait un tel rétablissement vis-à-vis des engagements internationaux de ces trois pays.
La Turquie, comme la France et le Royaume-Uni, est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) de 1950, qui prohibe clairement la peine de mort via son Protocole n°13 (2002), et cela en toutes circonstances. À ce titre, un rétablissement de la peine de mort signifierait donc la sortie immédiate de la Convention pour chacun de ces trois pays, et -par la même- de la juridiction de la Cour de Strasbourg (CEDH).
De la même manière, une telle décision marquerait la mort de la candidature d’adhésion turque à l’UE, puisque le Traité d’Amsterdam (1997) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) prohibent la peine capitale en des termes limpides. Ainsi, au fil des années, l’abolition de la peine de mort est devenue aussi bien une condition d’accession au statut d’Etat membre, que la « grande priorité de la politique des droits de l’Homme de l’Union ».
Un constat quasi-similaire s’impose pour le Royaume-Uni, qui n’est toutefois pas confronté au problème de la même manière (abolition plus ancienne et moins d’attentats, moins de populistes au pouvoir) et qui est –lui- un Etat membre de l’UE jusqu’à ce qu’un accord de sortie soit trouvé. Le rétablissement de la peine de mort entraînerait une sanction au titre de l’art. 7 du TUE qui vise à suspendre exceptionnellement un Etat membre de certains droits en cas de risque clair de violation grave des valeurs de l’UE. Cependant, quelle importance aurait-ce pour un Etat membre sur le départ, qui ne prend presque plus part aux décisions (Brexit mis à part) de l’UE ? On peut douter du poids de cette sanction dans ce cas précis.
Concernant l’impact sur l’appartenance du Royaume-Uni à la CESDH, les conséquences seraient les mêmes que pour la Turquie, ce qui accentuerait encore un peu plus le fossé qui sépare Londres des juges de Strasbourg, moins d’un an après l’annonce controversée par Theresa May de faire sortir l’armée britannique de la juridiction de la CEDH.
La France, fort heureusement n’est quant à elle pas sur le point de revenir à la peine de mort.
La tentation de la perpétuité incompressible en guise de compensation: une alternative insidieuse
Cependant, si la France n’entend pas revenir sur l’abolition de la peine de mort, une large partie de la population (52%) serait favorable au retour de la peine de mort selon les dernières études de l’ACAT. Toujours selon cette association, la corrélation entre cette progression et la multiplication des actes terroristes est évidente et démontrée. Se heurtant à une classe politique majoritairement abolitionniste, un rétablissement de la peine de mort semble exclu.
Toutefois, une autre peine semble fortement attirer les Parlementaires, qu’ils soient centristes, de droite, ou même de gauche: la perpétuité incompressible.
Cette peine consiste en le prononcé par une Cour d’assises spéciale[1] d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 30 ans. Dès lors, la personne écrouée ne peut pas disposer d’un fractionnement de peine, de la liberté conditionnelle ou de permission de sortie, avant trente ans de réclusion effective. En France, elle est extrêmement rare :
Premièrement, cette peine ne concernait jusqu’alors que deux crimes ; le meurtre d’un enfant de moins de 15ans accompagné de viol, actes de torture ou de barbarie, et le meurtre de policier ou magistrat à raison de leurs fonctions.
Deuxièmement, seul trois personnes sont aujourd’hui écrouées à perpétuité de façon “incompressible” dans les faits.
Cette rareté, qui fait monter au créneau les parlementaires habitués du refrain du laxisme judiciaire, a donc amené les députés à adopter début mars 2016 un amendement visant à ce que les condamnés à la perpétuité dans les affaires de terrorisme soient également concernés par la période de sûreté maximale. Ensuite adopté par les Sénateurs, c’est aujourd’hui le fameux art. 421-7 du Code pénal.
Alors, si elle n’est pas la peine de mort, la perpétuité incompressible en est la benjamine: née du même populisme pénal, la volonté populaire de condamner le plus lourdement possible celui que la société considère comme le premier ennemi de l’ordre public[2], en considérant d’emblée qu’aucune réinsertion n’est possible pour celui ou celle qui y est condamné. Elle est également une torture: le condamné sait qu’il n’a aucune chance de se racheter, qu’il mourra entre quatre murs, quoiqu’il fasse ; d’où son titre de « peine de vie » par ses détracteurs.
Nombreuses sont les inquiétudes des juristes à son encontre: premièrement, elle n’est nullement dissuasive pour les personnes susceptibles de passer à l’acte, et ne répond qu’à la démagogie pénale française de l’ « action-réaction » sans aucune vision à long terme. De plus, elle met les gardiens de prison (déjà en sous-effectif) en grand danger, car il est certain que de tels détenus n’auraient plus rien à perdre et seraient une menace constante pour le personnel pénitentiaire comme le confiait – de façon surprenante- l’ancienne Garde des sceaux Rachida Dati. Cette dernière pointait d’ailleurs du doigt la méconnaissance de notre système juridique, et notamment le principe d’individualisation des peines, par une telle réforme.
Il faut également ajouter à ce constat l’absence de prise en compte de l’objectif de réinsertion, pourtant omniprésent dans la réforme pénale de 2014. Si la réinsertion n’est pas toujours évidente à réaliser, une telle peine serait un incroyable rejet de cet objectif, ainsi qu’un manque de considération envers le travail du Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam (CPDSI) et du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Cela serait renoncer à cette « commune chance de réparation » que décrivait Camus dans ses Réflexions sur la guillotine (1957).
On sent là la trace du concept Feindstrafrecht* théorisé par Günther Jakobs dans les années 1980 – et longuement critiqué par le juge Paulo Pinto de Albuquerque- qui oppose notre droit pénal commun au « droit pénal de l’ennemi »* et dans lequel l’ennemi est celui qui a abandonné durablement le droit défini par le contrat social (1. Terroristes ; 2. Pédophiles et délinquants sexuels ; 3. Criminels économiques) – le premier attaque la société et le deuxième attaque l’avenir de la société ; d’où l’adoption de l’art. 421-7 CP sur le modèle de l’art. 221-3 du même code.
Yannick Lécuyer écrivait ainsi : « La perpétuité, par la durée de l’enfermement effectif et par les aléas de l’obtention effective d’une libération conditionnelle, annihile tout objectif sérieux de réinsertion et de protection du condamné dans la société. Elle résume la peine à une vengeance (sociale) et trahit subséquemment l’abolition de la peine de mort »
Pour autant, cette peine est-elle plus réalisable ? À vrai dire, oui et non.
Oui, en fait, car si la période de sûreté prévue par la loi doit toujours comporter une limite afin que puisse être réexaminée la peine d’un détenu, nulle législation française ne dispose que ce dernier soit en droit d’obtenir de façon automatique une libération ou quelconque fractionnement de sa peine. La libération et autres mesures prévues à l’art.132-23 CP résultent de l’avis rendu par un collège de trois experts médicaux sur l’état de dangerosité du condamné et les garanties de réadaptation sociale fournies ou non par le détenu (art. 720-4 CPP)
Non, en droit, car même si un détenu n’obtiendra pas nécessairement de libération ou fractionnement de sa peine, il doit néanmoins toujours pouvoir conserver l’espoir d’un réexamen de celle-ci.
C’est ici qu’intervient le juge de Strasbourg, qui a de façon constante rappelé que les condamnés à la perpétuité devaient conserver un « droit à l’espoir », sous peine pour l’Etat mis-en-cause d’être condamné en violation de l’art. 3 de la Convention et donc jugé responsable de torture et traitements inhumains ou dégradants. C’est ce qui ressort des arrêts de grande chambre Vinter et a. c. R-U (2013), Léger c. France (2009), et Kafkaris c. Chypre (2008).
La solution d’équilibre qui se dégage de la jurisprudence conventionnelle en la matière semble donc prouver qu’il est possible de condamner lourdement les auteurs d’actes terroristes, tout en respectant les droits de l’Homme, bien qu’il ne s’agisse souvent pour les peines de perpétuité que d’une « compressibilité de jure » non vérifiée en fait.
Dès lors, si la sévérité de la punition est naturelle, la fermeté du juge doit permettre de sauvegarder nos valeurs démocratiques en bloquant le chemin de la vengeance sociale, qui – s’il était emprunté- nous ferait rejoindre la spirale d’inhumanité que nous condamnons.
Paul Pouchoux
[1] Uniquement pour les affaires de terrorisme et grand banditisme
[2] Un sondage IFOP réalisé en avril 2016 arrivait à la conclusion que les jugements et les peines prononcées pour « terrorisme » n’étaient pas assez sévères pour 91% de Français.
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique