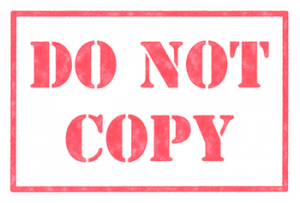Le dispositif réglementant en droit français le prêt dans les bibliothèques constitue une entrave au monopole des auteurs dont il était pourtant censé sauvegarder les intérêts.
En sa qualité de droit de propriété, le droit d’auteur est un droit de l’Homme (article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948), au même titre que le droit pour toute personne de jouir des arts (article 27). Tel est le paradoxe qui englobe la controverse relative au droit de prêt en bibliothèques : tous doivent accéder librement à la culture et tous les auteurs doivent voir leurs intérêts protégés.
A cet égard, comment concilier de manière équitable, d’une part les intérêts des auteurs en préservant leurs droits sur leurs œuvres communiquées au public par l’intermédiaire des bibliothèques et, d’autre part, l’intérêt général consistant à garantir à ce même public, un accès universel à la culture et à l’information ?
L’évolution amorcée par le Droit communautaire
C’est la Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui a jeté les bases du droit de prêt et de son articulation avec les régimes juridiques nationaux en matière de droit d’auteur.
Cette Directive n’a pas été à proprement parler transposée en droit français. Toutefois, elle a inspiré la Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 qui a inséré dans le Code de la propriété intellectuelle l’article L. 133-1 disposant que « lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. »
Le dispositif législatif mis en place reconnaît ainsi aux auteurs un droit à rémunération sur les prêts de leurs œuvres, tout en leur interdisant de s’opposer à ce prêt. Il s’agit donc d’un régime d’exception fondé sur une licence légale couplée à une gestion collective obligatoire, possibilités envisagées par la Directive du 19 novembre 1992.
De la sorte, les auteurs parvenaient enfin à obtenir une rémunération au titre du prêt de leurs œuvres, prérogative qui n’était que théorique jusque là. En revanche, ils perdaient concrètement le bénéfice du droit exclusif dont ils jouissaient en vertu des dispositions fondamentales de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Comme est venu le rappeler la Cour de Justice de l’Union Européenne le 30 juin 2011, l’objectif premier de la Directive était de garantir une rémunération équitable aux auteurs spoliés d’une partie de leur droit moral, faute de pouvoir s’opposer au prêt de leurs œuvres. A ce titre, « le montant [de cette rémunération] ne saurait être purement symbolique »
.
Certains y ont vu une conception réductrice du droit d’auteur, le ramenant à une simple gestion financière, au détriment du droit moral des auteurs.
Au-delà de la controverse suscitée par les modalités de collecte de cette contribution et la répartition de son produit, c’est surtout cette atteinte au droit moral qui prête le flanc à la critique.
Le choix critiquable d’une licence légale
La Directive du 19 novembre 1992 permettait aux Etats membres de déroger au principe, qui était, rappelons-le, le « droit d’autoriser au d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur », à condition que les auteurs obtiennent une rémunération au titre de ce prêt.
Il a été reproché au Législateur français d’avoir retenu l’exception au détriment de la règle de principe, mais aussi d’avoir bien inutilement exproprié les auteurs. Il est vrai que leur droit moral, par principe imprescriptible et inaliénable, se trouve réellement mis à mal par ce dispositif. Que fait-on dans ce cadre, notamment, du droit de retrait et de repentir de l’auteur ? Il s’agit pourtant de prérogatives essentielles. L’auteur se voit ainsi privé du contrôle de son œuvre.
Certes, une contrepartie sous forme de rémunération est prévue par les textes, renforcée par son caractère non cessible et d’ordre public. Mais cette rémunération forfaitaire va elle-même à l’encontre des principes traditionnels du droit d’auteur. Puisque la rémunération n’est pas directement liée au nombre de prêts de l’œuvre considérée, loin d’être associés au succès de leur œuvre, les auteurs se retrouvent au contraire, bel et bien coupés de leur création.
Il s’agit en réalité d’une évolution assez symptomatique de notre droit : la propriété littéraire et artistique évolue de manière de plus en plus sensible vers un droit à rémunération aux lieu et place d’un droit de propriété. Difficile alors de ne pas y déceler l’influence du copyright des pays de common law, dont le droit est centré sur une logique économique et non sur le lien entre l’auteur et son œuvre.
C’est là que réside la réelle anomalie de la Loi du 18 juin 2003, qui réduit une problématique juridique à une équation financière.
Pourtant, malgré l’avalanche de critiques sur les modalités du droit de prêt retenues en France, certains auteurs ont reconnu l’avancée constituée par la Loi du 18 juin 2003 en ce qu’elle remédiait à l’exemption généralisée résultant des divergences sur la présence implicite ou l’absence de droit de prêt dans le droit français antérieur, en lui donnant enfin un fondement et un régime de nature à concilier des intérêts divergents.
Une harmonisation encore en devenir
Vingt ans après l’adoption de la Directive, la convergence des systèmes juridiques en matière de droit de prêt n’est toujours pas d’actualité.
La Directive du 19 novembre 1992 s’en tient à son rôle de texte-cadre en réglementant les droits de prêt applicables à toutes les catégories d’œuvres. Pourtant, la Loi française du 18 juin 2003 a préféré se cantonner aux livres imprimés, ce qui risque d’accélérer l’obsolescence de ses dispositions, quand certains systèmes européens ont fait le choix d’étendre ce droit aux supports audio sans distinction.
Les auteurs d’œuvres littéraires se retrouvent ainsi nettement favorisés par rapport aux autres, ce qui ne semble guère conforme aux objectifs de la Directive.
Néanmoins, cette discrimination apparente se trouve minorée par des dispositions spécifiques ou des pratiques mieux encadrées, visant d’autres supports. Les logiciels sont protégés de manière efficace – en raison du risque élevé de piratage et d’utilisation abusive – puisque leur prêt est, le plus souvent, purement et simplement interdit, il est vrai, au détriment des usagers. Les vidéogrammes ont vu leur statut réglementé dès 1985, bien avant celui des livres. Leur prix de vente aux établissements de prêt est augmenté d’un forfait pour compenser le manque à gagner engendré par le prêt.
Si l’on reproche au livre d’avoir monopolisé la réflexion sur le droit de prêt, il semble que la situation n’ait rien d’irréversible. Au contraire, la diversification croissante des établissements de prêt, qui sont désormais davantage des médiathèques que des bibliothèques, imposera tôt ou tard l’adoption de nouvelles dispositions qui devront nécessairement respecter l’esprit de la Directive du 19 novembre 1992 et, espérons-le, rapprocher la réglementation des différents supports d’œuvres pour une plus grande équité entre leurs auteurs.
De nouveaux enjeux en perspective
Lors de l’adoption de la Loi du 18 juin 2003, une partie de la doctrine déplorait déjà l’absence de prise en compte du développement des supports numériques et des nouveaux modes de prêt, susceptible d’imposer rapidement l’adoption de nouvelles dispositions plus adaptées aux évolutions technologiques. Près de dix ans après, les mutations sont à l’œuvre et une révision du dispositif paraît plus que jamais nécessaire.
Il y a encore quelques années, le prêt concernait presque exclusivement des livres physiques circulant dans une zone géographique précise et limitée, en raison des contraintes matérielles mais aussi de la barrière de la langue. Désormais, le schéma n’est plus le même. Les plus pessimistes s’inquiètent sur le rôle à venir des bibliothèques, s’il n’y a plus de support matériel à exposer, si tout est téléchargeable à distance, mais aussi sur les risques évidents de piratage et de contrefaçon que ces nouveaux supports impliquent. D’une manière générale, c’est surtout le spectre d’une privatisation du patrimoine culturel – on pense notamment au projet Google Books visant à numériser le patrimoine des bibliothèques – qui alarme, à juste titre, ceux qui se soucient du libre accès à la culture.
Il est évident que l’usage d’une œuvre circulant sur un support dématérialisé est plus difficile à contrôler que celui d’un ouvrage édité sur papier. Désormais, une même œuvre pourra être « prêtée » simultanément à des dizaines de personnes par un établissement de prêt quand un exemplaire « papier » pouvait péniblement atteindre un tel score en une année entière.
Il convient de souligner que les incertitudes ne reposent pas uniquement sur les nouvelles pratiques mais aussi sur les nouvelles perceptions des usagers qui en résultent. Le développement des licences creatives commons, l’essor d’une culture du « libre » et du collaboratif, née de ce que l’on appelle le web 2.0 obligeront les acteurs de la chaîne du livre comme la législation à évoluer.
Dans ce contexte, l’influence croissante du droit communautaire en propriété littéraire et artistique a un double effet : si elle atténue l’exception culturelle française par l’harmonisation entre des pays aux conceptions éloignées, elle ancre simultanément dans notre législation un droit renforcé à une rémunération (plus ou moins) équitable.
Quelle que soit la solution retenue, afin que le droit d’auteur surmonte la crise de légitimité qu’il traverse aujourd’hui, le législateur devra remettre l’ouvrage sur le métier dans un avenir proche afin de parer aux assauts des investisseurs privés comme des tenants du « tout gratuit ».
Le tournant du numérique n’a pas fini de bouleverser les pratiques. De l’auto-édition à prix cassés au prêt de liseuses capables d’engranger des dizaines de milliers de titres, les mutations sont gigantesques. Il convient donc de s’attendre à de nouvelles évolutions législatives, que l’on espère équitables et respectueuses de notre exception culturelle comme du droit – y compris moral – des créateurs.
CJUE, 30 juin 2011, aff. C-271/10, VEWA C/ Belgische Staat.
Point 34 de l’arrêt précité.
Article 1er de la Directive du 19 novembre 1992
V. articles L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle et 5.1 de la Directive, énonçant respectivement que « ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur » et que « les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt »
Séverine GENTNER
Etudiante juriste
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique