Le 22 décembre 2011, l’Assemblée Nationale adopte la proposition de loi UMP visant à pénaliser la négation du génocide arménien de 1915, non sans susciter la polémique. Il en est résulté d’une part, des tensions diplomatiques entre la France et la Turquie (le gel de la coopération militaire, le rappel de l’ambassadeur turc à Paris). D’autre part, le débat est relancé à propos des lois dites « mémorielles », des enjeux qu’elles emportent tant au niveau de la liberté d’expression que des rapports entre droit et histoire. A ce sujet, certains universitaires se sont montrés hostiles à l’adoption de telles lois en droit français, comme en témoignent la pétition d’historiens français, de décembre 2005 « Liberté pour l’histoire » ou l’appel de 56 juristes en novembre 2006, réclamant l’abrogation de l’ensemble des lois dites mémorielles. Ces derniers affirment que « sous couvert du caractère incontestablement odieux du crime ainsi reconnu, le législateur se substitue à l’historien pour dire ce qu’est la réalité historique et assortir cette affirmation de sanctions pénales frappant tout propos ou toute étude qui viseraient, non seulement à sa négation, mais aussi à inscrire dans le débat scientifique, son étendue ou les conditions de sa réalisation. »
En marge des débats politiques et doctrinaux, il convient de s’intéresser à la nature juridique des lois mémorielles, dont la première a fait son apparition en droit français, il y a plus de vingt ans.
En France, plusieurs textes nationaux définissent et sanctionnent les génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 a instauré la reconnaissance officielle de la France du génocide arménien de 1915 et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. Il est possible de distinguer trois fonctions des lois dites mémorielles.
Tout d’abord, les lois dites mémorielles ont une fonction déclarative. Ainsi, la loi du 29 janvier 2001 composée d’un seul article reconnaissait le génocide arménien de 1915. Malgré la portée symbolique d’une telle loi, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 21 avril 2005, à l’occasion de laquelle il a déclaré contraire à la Constitution toute disposition législative jugée « manifestement dépourvue de toute portée normative». Aussi, dans son rapport annuel en 2005, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la continuité de la position du Conseil constitutionnel, en indiquant que « la loi est faite pour prescrire, interdire, sanctionner… La loi doit donc être normative ». Les lois qui se bornent à déclarer, et constater sans créer de droits ni d’obligations sont alors contraires à la Constitution car elles se résumeraient à un « bavardage législatif ».
Aussi, il est des lois mémorielles porteuses d’une « lecture non consensuelle d’un fait historique ». Ce type de loi interfère avec la recherche et l’enseignement de l’histoire en ce qu’elle délimite leur champ dans des domaines complexes ou controversés. Par exemple, la loi du 23 février 2005, qui fixait les droits des harkis, imposait une lecture positive de la colonisation française ainsi que le développement de recherches dans ce sens. Dans ce cas, l’aspect normatif de la loi s’est heurté à la liberté de l’historien, provoquant le lancement de nombreuses pétitions.
Enfin, certaines lois dites mémorielles créent véritablement de nouveaux droits et de nouveaux délits. Ainsi, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 réprime le déni du génocide juif d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. De même, la loi Taubira permet aux associations de se porter parties civiles dans des procès pour discrimination, diffamation ou injure. La loi du 22 décembre 2011, portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l’existence du génocide arménien fait partie de cette catégorie. Alors qu’en 2001, le législateur se bornait à reconnaître l’existence du génocide de 1915, le texte de 2011 réprime sa négation d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les lois mémorielles ont donc des portées différentes, et si le droit positif les connaît depuis maintenant plus de 20 ans (la première loi étant la loi Gayssot en date du 13 juillet 1990), elles semblent poser certains problèmes juridiques.
C’est d’abord par le prisme d’un principe phare du droit pénal que les lois mémorielles sont parfois critiquées : le principe de légalité des délits et des peines (article 111-3 du code pénal), énoncé dès le XVIIIème siècle par Beccaria, et selon lequel on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair (Nullum crimen, nulla pœna sine lege). Le principe à valeur constitutionnelle est notamment établi par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et l’article 7§1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Il est alors reproché aux lois mémorielles de comporter des termes larges et flous incompatibles avec la stricte interprétation de la loi pénale. La loi Gayssot a été notamment fustigée en ce qu’elle tendait à réprimer « tout propos raciste, antisémite ou xénophobe », termes qui n’étaient pas précisément définis par les textes de loi. Aussi, les députés affirment le 22 décembre 2011 que « le fait de contester ou de minimiser de façon outrancière l’existence d’un crime de génocide reconnu comme tel par la loi française est constitutif d’une infraction. ». La caractérisation du délit de « minimisation outrancière » est également à définir précisément.
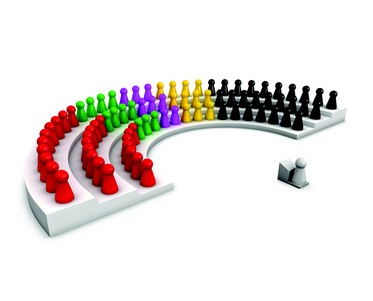
Par ailleurs, selon certains juristes, les lois dites mémorielles heurtent des principes constitutionnels. Il est notamment avancé que ces lois obéissent à une « logique communautariste », allant ainsi à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel qui affirmait que les principes fondamentaux de la Constitution « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999).
Enfin, il est dit que les lois mémorielles contreviennent au principe d’égalité entre citoyens, consacré dès l’article premier de la Constitution de la Vème République, en opérant une démarche spécifique à certains génocides et en en ignorant d’autres. En effet, l’article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, introduit par la loi Gayssot du 13 juillet 1990, incrimine et réprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la contestation de l’existence des seuls crimes nazis, à l’exclusion des autres crimes contre l’humanité. Toutefois, cette critique ne semble plus fondée avec le texte du 22 décembre 2011 car, s’il vise expressément le génocide arménien, il généralise l’infraction de négation à tout génocide reconnu par la loi française.
Malgré les doutes qu’elles soulevaient quant à leur constitutionnalité, les lois mémorielles n’avaient pas été déférées au Conseil constitutionnel jusqu’à la réforme du 23 juillet 2008 instaurant la Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC). Suite à cette révision, la loi Gayssot a fait l’objet d’une QPC, qui n’a toutefois pas été transmise au Conseil Constitutionnel, la Cour de cassation estimant qu’elle ne présentait pas un « caractère sérieux » au sens de la loi organique du 10 décembre 2009 (Arrêt n° 12008 du 7 mai 2010, 09-80.774).
Enfin, la proposition de loi du 22 décembre 2011, tendant à transposer la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur « la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal », illustre le caractère européen de ces lois dites mémorielles. Elles ont en effet pour but d’ancrer en droit positif la notion de « devoir de mémoire » et le rapport d’information du 18 novembre 2008 de M. Bernard Accoyer sur les questions mémorielles évoque bien les « contours d’une mémoire européenne ». Mais là encore, si la reconnaissance de tels actes est répandue dans la majorité des pays de l’Union Européenne, la pénalisation du négationnisme ne fait pas l’unanimité. Des disparités s’observent alors entre les différents Etats membres de l’Union Européenne.
En Allemagne, les personnes qui approuvent, contestent ou minimisent les crimes contre l’humanité sont passibles du délit d’incitation à la haine raciale, qui prévoit une peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. En 2005, le Bundestag a renforcé ces dispositions pénales en ajoutant la possibilité d’une peine allant jusqu’à 3 ans de prison pour la personne qui, « en public ou lors d’une manifestation, trouble l’ordre public d’une manière qui offense la dignité des victimes en approuvant, en faisant l’apologie ou en justifiant la violence et l’arbitraire du système national-socialiste ».
L’Autriche a l’une des législations les plus sévères parmi les pays de l’Union européenne en matière de lutte contre le négationnisme. Elle a réprimé dès 1945 par une loi d’interdiction les propos négationnistes.
En Suède, l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide définis par la charte du tribunal militaire international de Nuremberg ou le statut de la cour pénale internationale sont punies par la loi pénale du pays depuis 1964.
Toutefois, en Italie, en Espagne, ou encore au Royaume-Uni, la pénalisation de négation des génocides est limitée, au nom de la protection du principe de la liberté d’expression. C’est également le cas au Etats-Unis ; si un important arsenal législatif pour lutter contre les discriminations et les actes racistes et antisémites est mis en place, le principe de liberté d’expression porté par le premier amendement du Federal Bill of Rights limite très nettement la capacité des autorités à lutter contre la propagation des idées négationnistes, antisémites et racistes.
A l’initiative du député socialiste D. Migaud, une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Cependant, le Sénat, sans contester l’existence du génocide officiellement reconnu par la loi du 29 janvier 2001, l’a rejetée le 4 mai 2011 par l’adoption d’une exception d’irrecevabilité. M Hyest, sénateur de la Seine et Marne avait notamment rappelé que la responsabilité de la personne niant l’existence du génocide arménien pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La chambre haute a finalement définitivement adopté le texte le 23 janvier 2012 (126 voix contre 86).
Le 31 janvier 2012, le texte visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi a été déféré au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et sénateurs, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution.
Le 28 février 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi contraire à la Constitution (Décision n°2012-647-DC) ;
« Considérant qu’une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi ; que, toutefois, l’article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu’en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n’en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution »
Manel Chibane
L3 Droit, Paris II
|
Pour en savoir plus
Assemblée nationale, Question écrite n° 37941, Défense et anciens combattants.
La Semaine Juridique Edition Générale n° 48, 29 Novembre 2006, act. 563.
Article de vie-publique.fr sur les lois mémorielles. Article de vie-publique.fr sur la QPC
|
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique





