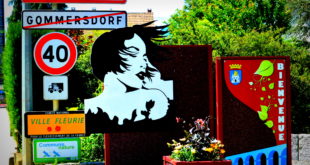En posant la question de l’abrogation de l’ordonnance du 16 brumaire an IX[1], un Sénateur de la Côte d’Or, a triomphé là où bien d’autres avaient échoué en faisant reconnaître l’abrogation implicite de cet acte et en mettant ainsi fin à une vague blague pseudo-juridique qui avait jusqu’alors cours dans des milieux fort peu rompus à la science de Thémis. La réponse de la ministre permet cependant de faire un rappel du droit de l’abrogation et de la théorie de l’abrogation implicite.
C’est par cette phrase des plus choquantes que Louis Lépine, préfet de son état, aurait entendu remettre en cause le port du pantalon, de la « culotte », par les femmes : « Il faut refuser aux femmes le port du pantalon. Elles perdraient tout attrait sexuel aux yeux des hommes ». Cette prédiction, visant à faire peser sur l’humanité le risque ultime de l’extinction si, d’aventure, les femmes avaient l’idée saugrenue de porter le pantalon, ne s’est, semble-t-elle, pas réalisée malgré la récurrente violation de l’ordonnance du 16 brumaire an IX par les femmes de la Capitale.
Saisie d’une question portant sur l’abrogation de ce texte, par ailleurs mal dirigée, la ministre du droit des Femmes, dans sa réponse, constate « l’abrogation implicite de l’ordonnance du 7 novembre [1800] » qui se voit « donc dépourvue de tout effet juridique », ne constituant « qu’une pièce d’archives conservée comme telle par la Préfecture de police de Paris ».
Pour mémoire, et comme le rappelle la ministre, cette « Ordonnance concernant le travestissement des femmes » avait pour but « de limiter l’accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l’image des hommes ». Les femmes pouvaient cependant demander une dérogation à cette interdiction de principe en vertu des articles 2 et 3 de cette ordonnance. Quelques dérogations furent acceptées, notamment pour des raisons de santé. A défaut d’autorisation expresse, « Toute femme trouvée travestie, qui ne [s’était] pas conformée aux dispositions [de l’ordonnance en cause], [était susceptible d’être] arrêtée et conduite à la préfecture de police ». Des dérogations d’ordre général et impersonnel étaient par ailleurs accordées, comme le rappelle le Sénateur dans sa requête, « si la femme [concernée tenait] par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval ».
Saisie, donc, de la demande d’abrogation de cette disposition ayant « une portée symbolique pouvant heurter nos sensibilités modernes », la ministre du droit des Femmes conclut à l’abrogation implicite de cet acte au regard de plusieurs textes que sont la « Constitution et les engagements européens de la France, notamment le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 1er de la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme ».
Un bref rappel du droit de l’abrogation s’impose donc (I) avant d’étudier les questions qui, malgré cette louable constatation, pèsent encore sur cette question (II).
I) Rappel éclair du droit de l’abrogation
Le rappel sera ici « éclair » comme le nom du mécanisme permettant la fermeture des pantalons dont les femmes peuvent actuellement se vêtir dans les rues de la « Ville Lumière ». Cependant, pour ce faire, il convient de distinguer l’abrogation d’un acte réglementaire d’autres mécanismes ayant pour objet ou effet de le remettre en cause (A) avant d’évoquer l’obligation pesant sur l’administration d’abroger les règlements illégaux (B).
A) Abrogation, retrait, désuétude ou le pantalon tripode.
En droit, l’abrogation est la méthode permettant à une autorité donnée de faire disparaître un acte et ses effets à une date donnée et uniquement pour l’avenir. A ce titre, l’abrogation ne doit pas être confondue avec le retrait de l’acte. En effet, contrairement à l’abrogation, le retrait d’un acte est rétroactif. L’acte retiré est donc censé n’avoir jamais existé, n’avoir jamais eu sa place dans l’ordonnancement juridique. En conséquence, tous les effets qu’il a pu produire doivent être effectivement anéantis pour retrouver la situation originelle. Concernant le retrait d’un acte réglementaire, comme celui présent en l’espèce, la jurisprudence considère que celui-ci est possible dans deux situations : soit l’acte réglementaire n’a reçu aucun commencement d’exécution, soit, au contraire, il a commencé à produire ses effets. Dans la première hypothèse, l’administration peut, pour des raisons d’opportunité ou de légalité, retirer l’acte en cause à tout moment, que celui-ci soit légal ou illégal[2]. A contrario, si l’acte est définitif et a déjà commencé à produire ses effets, il ne peut être retiré[3]. Un tel acte pourra cependant être retiré pour illégalité, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux, ou, dans le cas où un recours a été formé dans ce délai, pendant toute la durée de l’instance[4]. Notons, pour être complet, que certains actes peuvent être retirés pour tout motif et à tout moment par l’administration. Ainsi en va-t-il des actes obtenus par fraude[5] ou des actes inexistants[6] ; cette position semblant pouvoir bénéficier aux actes individuels et réglementaires.
L’abrogation ne doit pas, non-plus, être confondue avec la désuétude de l’acte. La désuétude est la situation dans laquelle un acte, toujours en vigueur, n’est plus respecté et n’a donc, dans les faits, plus aucune efficacité juridique malgré sa persistance dans l’ensemble normatif. Il en va par exemple ainsi du décret du 1er mars 1852 relatif au costume des fonctionnaires et employés dépendant du ministère de l’intérieur prévoyant que le costume officiel des maires se composent : « un habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à frange d’or ». Ces dispositions ont fait l’objet de plusieurs demandes d’abrogations au Ministre de l’intérieur, qui, se contentant de relever la désuétude de l’acte, n’a jamais pris la peine d’abroger ce texte[7].
Le régime de l’abrogation d’un acte réglementaire est, lui, est beaucoup plus simple à appréhender que celui, sus-évoqué, du retrait. En effet, ne disposant que pour l’avenir, il ne remet pas en cause de manière brutale les droits qu’il a pu faire naître. En conséquence, il peut être abrogé de manière assez libre par l’administration qui l’a produit. De même, et surtout, les administrés n’ont, d’après la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État, aucun « droit acquis au maintien d’une situation réglementaire »[8]. En conséquence, l’abrogation d’un acte réglementaire, étant réputée ne pas causer de tort aux administrés, ne souffre d’aucune difficulté juridique importante et peut donc, en principe, être réalisée à tout moment. Il en va néanmoins différemment si une disposition législative prohibe cette abrogation[9].
B) L’obligation d’abrogation en droit français
Quoiqu’il en soit, ce « droit d’abrogation » n’est pas aussi libre que la règle rappelée ci-dessus pourrait le laisser entendre. En effet, et pour commencer, l’administration ne doit pas appliquer les règlements qu’elle sait être illégaux, sauf à risquer de créer une seconde illégalité[10]. Cette règle, plus que l’abrogation même de l’acte en cause, vise, surtout, à en organiser la désuétude temporaire en attendant le remplacement ou, simplement, l’abrogation de la disposition réglementaire litigieuse.
Plus encore, l’administration est parfois tenue d’abroger un acte réglementaire.
Il en va notamment ainsi, d’après la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat, lorsque l’acte réglementaire discuté est devenu illégal pour cause de changements dans les circonstances de fait ou de droit[11]. Dans ce fameux arrêt, la juridiction suprême considérait en effet, qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver un règlement ont disparu, de saisir à toute époque l’autorité émettrice de l’acte en vue d’en obtenir sa modification ou à sa suppression et de se pourvoir, le cas échéant devant le Conseil d’Etat, contre le refus ou le silence de l’autorité concernée. Le non moins fameux arrêt Compagnie Alitalia étendra cette obligation. Ainsi, ne faisant que mentionner les dispositions du décret du 28 novembre 1983 (en ce qu’elles étaient l’un des moyens de la Compagnie), le Conseil d’Etat y considère que « l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date[12] ». Cette jurisprudence sera complétée par la suite sans qu’il soit ici besoin de développer d’avantage[13].
Outre ces apports jurisprudentiels, deux textes ont eu, ou ont toujours, pour objet et pour effet de forcer l’administration à abroger les actes réglementaires devenus illégaux (ou illégaux depuis l’origine). L’article 3 du décret du 28 novembre 2003[14] pré-cité disposait, en effet, que « L’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Elle-même abrogée en 2007[15], cette disposition, doublant avec la position des juges, reste active en notre droit puisque la loi du 20 décembre 2007[16], modifiant en ce sens les dispositions de la loi du 12 avril 2000[17], prévoit que « L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date[18] ». Le nouveau texte est donc plus large puisqu’il impose aux autorités administratives de pourvoir à ces abrogations de textes illégaux, même en l’absence de saisine préalable d’un administré.
La seule limite à cette abrogation, toute relative qu’elle soit, est liée au délai de prise d’effet de celle-ci. En effet, l’administration bénéficie d’un « délai raisonnable » avant d’abroger le texte considéré afin qu’elle puisse mettre en œuvre « les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d’égalité[19] ». Cette limite, temporaire, n’est que la transcription du principe général du droit de sécurité juridique qui sera consacré quatre ans plus tard par les juges du Palais-Royal[20].
Après ces quelques rappels, l’utile serait de nous intéresser de plus près à la constatation de l’abrogation, par la ministre, de la prohibition du port de « la culotte » jusqu’alors imposée aux femmes de Paris.
II) Une constatation justifiée mais théoriquement peu solide.
A la réflexion, et si, sur le fond, l’abrogation d’un acte relevant de mentalités que l’on espère être d’un autre âge est à saluer, il ne semble pas que le raisonnement qui ait conduit Madame la ministre à répondre de cette façon à l’édile soit, sur le plan théorique, des plus solides (B). Néanmoins, il aurait été bien difficile de procéder autrement, et l’action de la ministre prend alors tout son sens (A).
A) Une théorie de l’abrogation implicite bien à propos
Comme dit précédemment, donc, la Ministre du droit des femmes, pour justifier sa décision de ne pas abroger le texte en cause, s’est fondée sur la théorie de l’abrogation implicite. D’après cette théorie, un texte donné serait, en effet, implicitement abrogé, par la publication postérieur d’un texte de valeur égale ou supérieur dont les dispositions seraient contraires à celles prévues au premier. C’est ainsi qu’en l’espèce, la ministre relève la contradiction entre l’ordonnance décriée et des textes postérieurs de niveau supérieur (Constitution ; textes internationaux).
En principe, c’est le juge qui constate l’abrogation implicite d’un acte réglementaire par un texte postérieur supérieur. Il en va par exemple ainsi lorsqu’une disposition constitutionnelle nouvelle va à l’encontre d’un règlement antérieur. Peuvent, à ce titre, être cités l’abrogation implicite de certains articles des décrets impériaux du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux sur le double fondement des lois constitutionnelles de 1875 et du décret du 10 janvier 1872[21], ou encore l’abrogation de toute disposition réglementaire définissant les modalités de l’information du public sur les effets de la dissémination volontaire d’OGM sur le fondement de la Charte de l’environnement[22]. Une loi postérieure peut également implicitement abroger un acte réglementaire contraire ou certaines de ses dispositions, ce que le juge a déjà admis[23]. Dans un tel cas, cependant, le juge vérifiera que les dispositions réglementaires sont effectivement et directement contraires à la loi nouvelle et que les deux dispositions, a priori contraires, ne peuvent « cohabiter »[24]. Un acte international ou un autre acte réglementaire contraires et postérieures peuvent également implicitement abroger un acte administratif réglementaire.
Enfin, et pour mémoire, rappelons que le juge administratif est allé jusqu’à accepter d’annuler un acte administratif pris sur le fondement de dispositions législatives implicitement abrogées par une réforme constitutionnelle[25]. Cette position, étonnante par rapport à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État[26], connaîtra, dans le futur, une bien moindre application, eu égard à la mise en place du mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le fondement de cette théorie, donc, la ministre a déclaré l’abrogation de l’ordonnance critiquée. Force est, à ce titre, de constater que, si la méthode choisie n’est pas exempte de critiques, on y reviendra, cette solution apparaît comme étant l’une des moins mauvaises d’un point de vue juridique. D’autres méthodes auraient pu être étudiées mais sans le succès escompté.
Ainsi, il eut, par exemple, été impossible, contrairement à ce qui avait été demandé par le Sénateur, d’abroger, par un acte explicite, l’ordonnance du Préfet Dubois. En effet, l’abrogation n’étant, par nature, et comme rappelé ci-avant, pas rétroactive, un tel acte aurait légitimé, a posteriori, l’existence de l’ordonnance discriminatoire pour la période allant de 1800 à 2013. En quelque sorte, abroger explicitement le texte en cause en 2013, aurait conduit, implicitement d’ailleurs, à reconnaître l’existence juridique de l’ordonnance préfectorale jusqu’à la date même de son abrogation. Une telle reconnaissance implicite de l’existence de l’acte n’aurait pas manqué de faire sourire certains juristes par son effet contradictoire et paradoxal. De même, l’effet symbolique escompté par le parlementaire quant à cette abrogation, en aurait été anéanti par la reconnaissance implicite du texte qu’elle engendrait. Or, en constatant l’abrogation implicite de ce texte du fait du Préambule de la Constitution de 1946, la ministre fait, en pure fiction juridique, remonter la mort de l’acte à 1946 et justifie ainsi son inexistence en 2013. Dans une telle logique, impossible d’abroger cet acte, déjà inexistant. La non-rétroactivité de principe des actes réglementaires[27] s’opposait, également, en pur droit, même si personne ne s’en serait vraisemblablement plaint, à ce que l’autorité administrative abroge explicitement ce texte avec prise d’effet plusieurs années auparavant. Du reste, une telle rétroactivité serait nécessairement entrée en conflit avec les décisions, toutes rares fussent-elles, ayant conduit à la condamnation de femmes sur le fondement de l’ordonnance du 16 Brumaire an IX. En conséquence, et dans l’hypothèse où une telle décision serait possible en pur droit, la date expresse d’abrogation serait, dans ces circonstances, très difficile à fixer et serait nécessairement arbitraire (on pourrait, par exemple, imaginer d’abroger le texte à partir de la dernière condamnation connue sur ce fondement pour éviter que les sanctions prononcées se télescopent avec cette abrogation… mais l’arbitraire historique rôde derrière une telle position).
Le retrait de l’acte était également impossible puisque les conditions de ce retrait n’étaient pas réunies. En effet, l’acte, au moment de sa proclamation, n’était pas illégal. Du reste, cet acte, devenu définitif et ayant servi de fondement à des condamnations, avait clairement et sans ambiguïté produit ses effets. L’annulation rétroactive était donc dépourvue de fondement et clairement illégale, en plus des questions d’opportunités liées, comme pour l’abrogation rétroactive, au risque de télescopage potentiel entre l’annulation de l’acte et les condamnations d’ors et déjà prononcées sur son fondement.
On le voit donc, la ministre n’avait pas d’autre possibilité technique permettant de nier l’existence juridique de cet acte. Néanmoins, la position ministérielle n’est pas dénuée de toute fragilité.
B) La fragilité théorique de cette constatation
La première fragilité n’est pas juridique et essentiellement orthographique. En mentionnant expressément la « Convention européenne des droits de l’homme » comme une garantie de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en omettant la majuscule qui sied à la qualification d’Homme, la ministre ne sert pas, loin s’en faut, son argumentation.
Plus juridiquement, la compétence de Madame la ministre pour constater l’abrogation implicite d’un texte se pose sur plusieurs terrains. Premièrement, il est constant que l’acte en cause est une ordonnance préfectorale prise, comme son nom l’indique, par un préfet. Constater l’abrogation, si tant est que cela soit possible, d’un acte de police pris par un préfet ne devrait-il pas, dans ces circonstances, revenir à la compétence du ministre de l’intérieur ou du Premier ministre ? Dès lors, la compétence rationae personae de la seule ministre du droit des femmes pour constater l’abrogation de cette ordonnance peut être discutée. Néanmoins, cet argument peut être nuancé en ce que l’article 2 du décret de 29 avril 2004[28] qui dispose que « les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets […] sont adressés aux ministres compétents ». Or, en la matière, la compétence de la ministre du droit des femmes s’entend relativement bien, même si une saisine conjointe du ministre de l’Intérieur, par exemple, n’aurait pas été superflue ; cet acte ayant été pris sur le fondement de ce que l’esprit du temps considérait comme un impératif d’ordre public.
Quoiqu’il en soit, la compétence même d’un ou d’une ministre pour constater l’abrogation implicite d’un règlement prête au doute. En effet, jusqu’alors, la constatation d’une abrogation implicite se faisait par le juge. Il est, en effet, différent, de prononcer l’abrogation d’un acte par une décision expresse et de, simplement, constater que des textes sans rapport avec l’objet de l’acte en cause, l’ont, postérieurement et implicitement, abrogé. Cette forme « d’incompétence positive » n’est pas sans conséquence puisqu’elle pose la question, en poussant le raisonnement, de l’intégrité du principe de l’indépendance de la justice. En effet, quelle sera l’éventuelle conséquence contentieuse de cette constatation ? Imaginons, en effet, qu’un individu saisisse la ministre d’une demande d’abrogation de cette ordonnance. Celle-ci, explicitement ou implicitement, refuse de faire droit à cette demande pour les raisons invoquées dans sa réponse au Sénateur. Que se passera-t-il si le juge est saisi de ce refus ? Suivra-t-il, sans plus de précautions, l’avis de la ministre ? Se sentira-t-il tenu par cette interprétation en rejetant la demande comme étant « sans objet » puisque dirigée contre un acte inexistant ou procédera-t-il à l’examen au fond de la requête, quitte à, lui-même, constater l’abrogation implicite de ce texte, rendant, in fine, la requête sans objet ? A l’extrême, ne constatant pas lui-même l’abrogation implicite (ce qui serait quasi-surnaturel), pourrait-il enjoindre à l’administration d’abroger ce texte illégal dans un délai déterminé, sur le fondement des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative[29] ? Bien entendu, cela reste une hypothèse d’école mais sympathique à la réflexion…
Suivant la même idée, n’y-a-t-il pas là, dans l’absolu, une sorte de contradiction entre les dispositions sus-évoquées de la loi du 20 décembre 2007 et cette simple constatation de l’abrogation implicite ? En effet, d’après cette loi, l’administration a l’obligation de pourvoir à l’abrogation des dispositions réglementaires qu’elle sait être illégales. Or, en l’espèce, et comme dit précédemment, l’administration n’a pas pourvu à cette abrogation, malgré le caractère manifestement inconstitutionnel, inconventionnel et illégal de ce texte, se contentant de relever que l’ordre juridique le privait d’existence. Cette interrogation, ne s’arrêtant pas aux faits de l’espèce, pose, de manière plus fondamentale, la question de l’éventuelle contradiction entre la loi de 2007 et la théorie de l’abrogation implicite. En effet, dans ce cas, la loi impose ce que la théorie de l’abrogation implicite rend inutile…
Pour ce sortir de ces interrogations, deux possibilités s’offraient à l’administration : Soit constater la désuétude du texte, soit faire naître un contentieux permettant au juge de se prononcer sur ce texte.
La première hypothèse est cependant limitée car, contrairement à la question de l’uniforme des maires évoquée ci-avant, l’ordonnance du 16 Brumaire an IX est manifestement illégal ; ce qui impose l’abrogation. Néanmoins, l’on peut réellement s’interroger sur la véritable portée du développement de la ministre qui, sous couvert de constater l’abrogation semble, sous certains aspects, s’être contentée de prouver la désuétude de ce texte.
La seconde possibilité est la plus « propre » d’un point de vue juridique même s’il apparaît complexe de permettre un tel contentieux. Là encore, deux possibilités étaient ouvertes et notamment celle (nous osons!) d’infliger une peine à une femme portant le pantalon à Paris afin que celle-ci excipe de l’illégalité de cet acte réglementaire pour que le juge en apprécie la validité juridique. Bien entendu, cette remarque n’est que pure provocation… L’autre méthode, plus correcte, aurait consisté à demander l’abrogation du texte et à faire naître une décision de refus qui aurait été déférée devant le juge administratif… Et ce, dans le seul but de faire progresser le droit ; les normativistes apprécieront !
Morgan Reynaud.
Pour aller plus loin :
- BARD (Ch.), Le « DB58 » aux Archives de la Préfecture de Police », CLIO. Histoire, femmes et sociétés : http://clio.revues.org/258 ;
- CROUZATIER-DURAND (F.), La fin de l’acte administratif unilatéral, 2003, éd L’Harmattan ;
- DEVOLVE (P.), Retrait et obligation : le cas des actes à objet pécuniaire et des actes obtenus par fraude : RFDA 2003.240 ;
- EVEILLARD (G.), Abrogation implicite ou inconstitutionnalité de la loi ? Les vicissitudes de l’ abrogation implicite de la loi par une disposition constitutionnelle postérieure, entre postériorité et supériorité, RFDA 2011.353 ;
- GATE (J.) : Abrogation implicite : le port du pantalon par les femmes est juridiquement permis à Paris ! : http://libertees.blog.lemonde.fr/2011/08/11/abrogation-implicitele-port-du-pantalon-par-les-femmes-est-juridiquement-permis-a-paris/
- MILHAT (C.), L’acte administratif, entre processus et procédures, 2007, éd du Papyrus.
[1] Abrogation de l’interdiction du port du pantalon pour les femmes, Question écrite n° 00692 de M. Alain Houpert (Côte-d’Or – UMP) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 – page 1534
[2] CE, 21 octobre 1966, Graciet : Rec p.560
[7] Voir notamment : Question écrite n° 35693 de M. Serge Mathieu, Sénateur UMP du Rhône ; Question écrite n°3363 de M. Dominique Baert, Député SRC du Nord
[8] Voir notamment : CE, 27 janvier 1961, Vannier, Rec p.60 ; CE, 5 mai 1972, Melle Noyer, Req n°83752 ; CE, 18 mars 1977, CCI de La Rochelle, Belfort et Lille-Roubaix-Tourcoing, Req n°97939 97940 97941 ; CE, 13 décembre 2006, Lacroix, Req n°287845
[9] Voir notamment l’ancien article L123-4-1 du Code de l’urbanisme, abrogé depuis, qui rendait impossible l’abrogation d’un plan local d’urbanisme.
[10] CE, 14 novembre 1958, Ponnard : Rec p.544.
[11] CE, 10 janvier 1930, Despujol, Rec p.30.
[14] Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers
[15] Art 20 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
[17] Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
[18] Art 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
[23] Voir par exemple : CE, 4 juillet 1986, SGEN-CFDT, Req n°46649
[26] Rappelons, pour mémoire, que le Conseil d’État se refuse traditionnellement à contrôler la constitutionnalité d’un acte d’application si ce contrôle a pour effet d’opérer un contrôle de la constitutionnalité de la loi sur le fondement de laquelle l’acte administratif querellé à été pris. C’est la théorie de la loi-écran posé par l’arrêt Arrighi du 6 novembre 1936. L’introduction, en droit français, de la QPC remet cependant cette théorie en cause.
[28] Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
[29] Voir, par exemple, sous l’empire de la loi du 16 juillet 1980 : CE, 20 mars 2000, GISTI, Req n°205266
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique