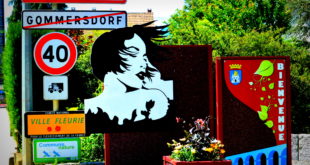Contrairement à ce qu’affirmait Henrion de Pansey en 1863, juger l’administration ne revient pas à administrer.
En effet les nombreux changements, voire révolutions, qu’a connus la juridiction administrative en a fait une juridiction indépendante à part entière, au même titre que la juridiction judiciaire.
La France fait partie des sociétés occidentales qualifiées d’État de droit, c’est-à-dire un Etat démocratique dans lequel les autorités doivent, pour être respectables et respectées, se soumettre d’elles-mêmes à la règle de droit.
C’est le but même de la juridiction administrative, qui va par son contrôle sur l’administration garantir le bon fonctionnement et les exigences de l’État de droit.
Cependant, ce statut et cette indépendance ont été gagnés au fil du temps.
La juridiction administrative a commencé à être reconnue par les lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III, qui interdisaient aux autorités judiciaires de se mêler des affaires des juridictions administratives.
Mais, ce n’est qu’avec la création du Conseil d’État en 1799 et avec la loi du 24 mai 1872 que la justice fut déléguée.
Il fallut cependant attendre l’arrêt Cadot de 1889 pour qu’enfin le Conseil d’État mette fin à la théorie du ministre juge et juge « au nom du peuple Français ».
La création du tribunal des conflits par la loi du 28 Pluviôse An VIII permit aussi de garantir la dualité juridictionnelle entre juge judiciaire et juge administratif.
De plus, le Conseil constitutionnel a également contribué à la répartition des compétences dans sa décision du 16 juillet 1987 sur le conseil de la concurrence, en déclarant que relèvent de la juridiction administrative en dernier ressort l’annulation ou la modification des actes pris selon les prérogatives de puissance publique.
Cependant, afin de rendre la justice plus accessible, ont été créés des tribunaux administratifs, par la loi du 23 septembre 1953, puis des Cours administratives d’appel par la loi du 31 décembre 1987, afin de permettre au Conseil d’État de se concentrer sur sa fonction première, celle de juge de cassation.
Les conseillers de ces juridictions, quant à eux, ont acquis la qualité de magistrat et la reconnaissance de leur indépendance par une décision du Conseil constitutionnel de 1980 et par un décret de 2010.
La juridiction administrative permet donc de garantir l’État de droit en réglant des contentieux.
Cependant, un conflit avec l’administration peut être réglé avant de passer par la justice administrative. En effet il est toujours possible, et ce dans tous les cas, de tenter un recours amiable auprès de l’administration concernée.
Dans certains cas, il est même obligatoire de faire un recours administratif préalable. Dans un arrêt du Conseil d’État de 2006 Leroy Merlin, le juge déclare qu’il y aura recours administratif préalable obligatoire pour les décisions des instances ordinales, même si aucun texte ne le prévoit.
De même, l’administration peut également avoir recours à la transaction ou à l’arbitrage, même si cela reste des moyens très peu utilisés.
La transaction sera basée sur des concessions réciproques, mais l’administration ne sera jamais tenue de payer une somme qu’elle ne doit pas (CE 1979 Mergui).
Quant à l’arbitrage, les parties décideront à l’avance du mode de règlement du conflit, et incorporera le plus souvent une clause de renonciation juridictionnelle.
En outre, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’administré qui se sent lésé par la gestion d’un service public pourra faire appel au Défenseur des droits, selon l’article 71-1 de la Constitution.
La justice administrative dispose donc de nombreux moyens pour s’assurer que l’administration respecte les exigences de l’État de droit, que ce soit en incitant l’administration à agir dans tel ou tel sens, ou en réparant les dommages causés par celle-ci.
Ainsi, la justice administrative dispose de moyens pour rendre l’État de droit plus efficient (I), mais peut également, pour s’assurer du respect de l’État de droit, juger l’administration (II).
I. Une justice administrative disposant de moyens pour rendre l’État de droit plus efficient
Afin de rendre l’État de droit plus efficient, la justice administrative dispose de moyens pour contraindre l’administration (A), mais également de moyens pour accélérer la prise de décision de l’administration (B).
A. Des moyens pour contraindre l’administration
L’administration a souvent fait preuve de mauvaise volonté pour exécuter les décisions de justice, et ce même si les décisions sont exécutoires de plein droit et disposent du privilège du préalable, et ce pour des raisons politiques.
Cependant, si l’administration n’exécute pas, c’est parfois parce qu’elle n’en a pas les moyens, les juridictions n’étant pas extensibles.
Le juge a donc dû mettre en place des procédés pour inciter, voire contraindre si nécessaire, l’administration à appliquer effectivement les décisions rendues.
Le premier degré est la persuasion. Une autorité ministérielle pourra être saisie, ou encore la section rapport et études du Conseil d’État. Cette dernière, si elle note une mauvaise volonté de la part d’une administration, pourra le publier dans son rapport public.
Puis, la loi du 16 juillet 1980 est venue donner au juge administratif le pouvoir de prononcer des astreintes. L’astreinte correspond à une somme d’argent due par l’administration, par jour, jusqu’à ce qu’elle exécute la décision [1]. Cependant, l’astreinte devra être liquidée par le juge, et le juge pourra également prononcer des astreintes préventives.
Il existe une autre astreinte, qui est celle qui concerne une collectivité publique qui a été condamnée judiciairement à une somme d’argent. Dans ce cas là, la dépense doit être ordonnancée dans un délai de deux mois. Si ce n’est pas le cas, elle pourra être directement inscrite au budget soit par l’autorité de tutelle soit par une chambre régionale des comptes, et l’agent responsable pourra voir sa responsabilité engagée devant la Cour budgétaire de discipline.
De plus, la loi du 8 février 1995 est venue compléter ce dispositif avec le pouvoir d’injonction. Le juge peut donc enjoindre à l’administration de faire ou de ne pas faire quelque chose.
En 1954, le Conseil d’État rappelle que le juge peut prendre des mesures d’instruction et d’injonction [2]. Il l’a rappelé plus récemment dans un arrêt de 2002 Danthony, précisant que le Premier ministre doit prendre les mesures d’application de la loi.
Le Conseil d’État, qui disposait du pouvoir d’injonction avant la loi de 1995, contrairement aux tribunaux et cours administratives d’appel, était cependant frileux à l’idée de l’utiliser, considérant que cela revenait à administrer.
Mais, sachant que les tribunaux et cours d’appel allaient détenir ce pouvoir et que ces juridictions seraient beaucoup plus décomplexées à utiliser ce pouvoir, il se mit à utiliser ce procédé.
Outre les moyens pour contraindre l’administration et donc favoriser le respect de l’État de droit, la justice administrative dispose également de moyens pour accélérer la prise de décision de l’administration (B).
B. Des moyens pour accélérer la prise de décision de l’administration
Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la justice doit être rendue dans un délai raisonnable.
Pour permettre au juge de traiter des affaires dans l’urgence, ont été mis en place des référés. Il existe donc dorénavant des procédures d’urgence positives et des procédures d’urgence négatives.
Les procédures d’urgence positives vont permettre d’obtenir quelque chose, comme dans le cas par exemple des référés contractuels, précontractuels, ou d’instruction.
Le référé conservatoire de l’article 521-3 du Code de justice administrative (CJA) permet au juge de prendre toutes les mesures utiles dans le cadre d’un litige. Cependant il doit y avoir urgence, les mesures doivent être provisoires et ne doivent pas faire obstacle à l’exécution d’une décision.
Quant aux procédures d’urgence négatives, elles ont subi de grands changements avec la loi du 30 juin 2000.
Par exemple, la procédure de sursis à exécution a été modifiée et est devenue le référé suspension (article 521-1 du CJA). Alors que le sursis à exécution était très difficile à obtenir, car le juge demandait un moyen sérieux quant à la légalité et un préjudice difficilement réparable, le référé suspension se contente d’un doute sérieux quant à la légalité, et les conséquences difficilement réparables ont été remplacées par la condition d’urgence.
De plus, alors que la jurisprudence Amoros [3] empêchait le sursis à exécution à l’égard des décisions de rejet de l’administration, la loi du 30 juin 2000 les autorise.
Cette loi de 2000 a créé une véritable révolution en créant à l’article 521-2 le référé liberté. En effet, quand il existe une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, par une personne publique ou une personne privée chargée d’un service public, le juge des référés doit statuer dans un délai de 48 heures et prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l’atteinte [4].
Il existe également d’autres référés, notamment en matière environnementale.
De plus, le préfet peut également, dans le cadre de son contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, suspendre une décision. Dans ce cas là, le préfet dispose d’un privilège car la condition d’urgence n’est plus requise. Il peut également vendre, quand une commune doit des sommes d’argent, les biens non nécessaires au bon fonctionnement du service public [5].
Il est donc indéniable que la justice administrative dispose de moyens pour rendre l’État de droit plus efficient.
Mais outre cet aspect, la justice administrative peut également juger l’action de l’administration, afin de s’assurer qu’elle respecte bien les exigences de l’État de droit (II), et prendre les mesures pour pallier d’éventuelles insuffisances.

II. Une justice administrative jugeant l’action de l’administration pour s’assurer du respect de l’État de droit
En cas d’erreur de l’administration remettant en cause l’État de droit, la justice administrative a la possibilité d’annuler une décision de l’administration (A), ou encore d’engager la responsabilité de cette dernière (B).
A. La possibilité d’annuler une décision de l’administration
L’administration n’est pas infaillible et peut commettre des erreurs. Dans ce cas là, il est important de pouvoir y remédier, notamment en annulant les actes entachés d’illégalité.
Le justiciable dispose donc de la possibilité de demander l’annulation d’un acte en effectuant un recours pour excès de pouvoir. Ce recours est un recours objectif en annulation, dans l’intérêt du droit et non pas dans l’intérêt d’un droit.
Le recours pour excès de pouvoir sera obligatoirement formé contre un acte administratif unilatéral, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas être formé contre autre chose, comme par exemple contre un acte de gouvernement, une mesure d’ordre intérieur ou un contrat.
Cependant, il existe des exceptions. Ainsi, il pourra y avoir recours pour excès de pouvoir contre des actes détachables, c’est-à-dire ceux qui ponctuent la procédure de passation d’un contrat [6], les contrats de recrutement des agents publics [7], ou encore les dispositions réglementaires d’un contrat [8]. Si le juge accepte d’annuler ces dispositions, il ne sera cependant pas en mesure d’annuler le contrat. Dans ce cas, il faudra qu’il saisisse le juge de plein contentieux, afin que celui-ci puisse annuler le contrat.
Dans le cadre d’un contrat, donc dans l’hypothèse d’un droit subjectif lésé, le justiciable devra effectuer un recours de plein contentieux, où le juge pourra prononcer une indemnisation, ce qui ne pourra pas être le cas dans le cadre de l’excès de pouvoir.
Le juge, craignant de voir le recours pour excès de pouvoir tomber en désuétude, notamment à cause de la possibilité de faire des recours objectifs de plein contentieux, décida de moduler les effets d’une annulation [9]. Ainsi, il peut désormais prononcer l’annulation à une date ultérieure ou moduler les effets rétroactifs.
Cependant, tout le monde ne peut pas engager un recours pour excès de pouvoir, même si c’est dans l’intérêt du droit et donc de l’État de droit.
En effet, le requérant doit être capable et avoir un intérêt à agir. L’acte doit lui faire grief, et ce grief doit être certain, personnel, légitime, et suffisamment direct, et de plus le requérant doit appartenir à une catégorie limitée d’administrés.
Alors qu’avant il fallait l’existence d’un droit subjectif lésé, la jurisprudence Casanova [10] n’exige plus qu’un intérêt à agir, et dorénavant il peut y avoir recours pour excès de pouvoir même si aucun texte ne le prévoit [11].
De plus, ce recours ne pourra être ouvert que dans certains cas, uniquement quand il existe des illégalités externes ou des illégalités internes.
Les illégalités internes seront l’incompétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme ou le détournement de procédure [12], tandis que les illégalités externes seront le détournement de pouvoir [13], l’erreur sur l’exactitude matérielle des faits [14], ou encore l’erreur quant à la qualification juridique des faits [15].
Dans le cadre de la qualification juridique des faits, le juge s’assura également de la proportion de la mesure [16]. Il pourra ainsi effectuer, selon la marge d’appréciation de l’administration, un contrôle restreint sur l’erreur manifeste d’appréciation quand l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, un contrôle normal quand l’administration est en situation de compétence liée, ou un contrôle maximum.
Il existe également des contrôles dissymétriques, ou des contrôles qui sont à la fois restreint et maximum [17].
Outre la possibilité d’annuler une décision de l’administration, l’État de droit exige la possibilité pour la justice administrative de mettre en jeu la responsabilité de l’administration (B).
B. La possibilité d’engager la responsabilité de l’administration
Pendant longtemps, l’adage consistait à dire que « le roi ne peut mal faire » [18] ; il était donc impossible d’engager la responsabilité de l’administration.
Petit à petit l’idée de responsabilité a émergé, mais très superficiellement tout d’abord.
L’article 75 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII subordonnait l’engagement de la responsabilité des agents à une autorisation préalable du Conseil d’État, ce qui en pratique leur conférait une immunité, le Conseil d’État refusant quasiment toujours de délivrer l’autorisation.
Puis, simultanément à l’indépendance de la juridiction administrative, l’idée d’une responsabilité de l’administration s’est étoffée.
Le décret-loi de 1870 mit fin à l’obligation de recourir à l’autorisation du Conseil d’État, mais c’est véritablement l’arrêt Blanco [19] qui consacra la responsabilité de l’État. Cependant, cette responsabilité ne pouvait être ni générale ni absolue, et elle ne pouvait pas être régie par le droit commun.
Dorénavant, il existe donc la possibilité pour la justice administrative de reconnaitre la responsabilité de l’administration, que ce soit pour faute ou sans faute.
La faute est, selon Planiol [20], « un manquement à un devoir prédéfinit ».
La jurisprudence Pelletier [21] fait la distinction entre faute personnelle et faute de service. Ainsi, s’il s’agit d’une faute personnelle, le requérant aura l’obligation d’aller devant le juge judiciaire, alors que s’il s’agit d’une faute de service il faudra aller devant le juge administratif. Par cette répartition des rôles, cet arrêt renforce la dualité juridictionnelle.
La faute personnelle est celle qui « révèle l’homme avec ses imprudences, ses faiblesses et ses passions » [22]. Quand celle-ci est commise en dehors du service, cela ne posera aucun problème car ce sera le droit commun qui s’appliquera.
En revanche, il peut arriver que la faute personnelle soit commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci [23], ou commise pendant le service mais détachable de celui-ci. Dans cette dernière hypothèse, ce sera par exemple le cas d’une faute non intentionnelle mais d’une telle gravité qu’elle sera injustifiable [24], ou intentionnelle [25].
Dans ces cas là, le requérant devra obligatoirement aller devant le juge judiciaire. Cependant, pour éviter le risque d’insolvabilité de l’agent, la jurisprudence a prévu trois cas dans lesquels il sera possible pour la victime soit d’engager la responsabilité devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif.
Il s’agira de l’hypothèse du cumul de fautes, en cas de faute personnelle et de faute de service [26], du cumul de responsabilité en cas de faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci [27], ou de cumul de responsabilité en cas de faute personnelle commise dans le cadre du service [28].
Cependant, si l’administration a été condamnée du fait des arrêts Anguet, Demoiselle Mimeur ou Époux Lemonnier, elle pourra se retourner contre son agent par le biais d’une action récursoire [29].
Dans certains cas, l’administration pourra engager une action directe contre son agent, si son comportement lui a causé un préjudice.
De plus, outre la distinction entre faute personnelle et faute de service, le juge va également faire la distinction entre faute lourde et faute simple, en fonction de la difficulté de la tâche que doit effectuer l’administration.
S’il s’agit d’une activité ne présentant aucune difficulté le juge retiendra la faute simple, tandis que s’il s’agit d’une activité compliquée il retiendra la faute lourde.
Cependant, selon l’adage, « l’histoire de la faute lourde est celle de son recul » [30].
En effet, dans le souci de garantie de l’État de droit, le juge aura tendance plus facilement à engager la responsabilité de l’administration.
La faute lourde a donc été abandonnée pour les actes médicaux [31], les activités de secours [32], et les activités des services pénitentiaires [33].
Cependant, la faute lourde subsiste toujours pour les activités des juridictions administratives, les activités de contrôle, et les activités fiscales, hormis celles d’établissement et de recouvrement de l’impôt, qui sont maintenant passibles de faute simple, sauf si le cas présente des difficultés majeures.
En outre, ce sera à la victime de prouver la faute de l’administration, hormis dans de rares cas, comme les travaux publics, où l’administration sera présumée coupable et devra prouver qu’elle n’a pas fauté.
Sous la pression de l’opinion publique et pour garantir toujours mieux les exigences de l’État de droit, la justice administrative a petit à petit accepté l’idée de reconnaitre la responsabilité sans faute de l’administration.
Cette responsabilité sans faute a notamment été consacrée en 1895 [34] ; cependant, il s’agissait uniquement de travaux publics.
La responsabilité sans faute peut être fondée sur le risque, subit par les administrés eux-mêmes ou par les collaborateurs de l’administration, que ce soit pour les choses dangereuses [35], les méthodes dangereuses [36], les attroupements [37], ou encore les travaux ou les ouvrages publics.
En 1946, le Conseil d’État reconnait la possibilité pour un collaborateur occasionnel d’engager la responsabilité de l’administration [38].
La responsabilité sans faute peut également être fondée sur la garde [39], qui concerne notamment les familles d’accueil.
De plus, la responsabilité sans faute peut également être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques, quand cette rupture cause un préjudice anormal et spécial. Cette rupture d’égalité peut être du fait des actes administratifs même légaux [40], du fait des lois [41], ou du fait des conventions internationales [42].
Le Conseil d’État a été très réticent à prononcer la responsabilité sans faute du fait des conventions internationales, étant donné qu’il ne l’a fait que deux fois depuis l’arrêt de principe de 1966. Cependant, dans un arrêt du 11 février 2011 Suziwakala, il reconnait pour la troisième cette possibilité.
L’arrêt Gardedieu de 2007 avait effectivement prévu l’engagement de la responsabilité de l’État en cas de méconnaissance des engagements internationaux, et ce même si une loi en disposait autrement.
Cependant, avant d’engager la responsabilité de l’administration, le juge vérifiera que le préjudice est certain et qu’il y a un lien de causalité avec l’action de l’administration.
En ce qui concerne les biens matériels, le juge fixera l’indemnité à la date à laquelle le dommage est survenu [43], alors qu’en ce qui concerne les préjudices aux personnes, il fixera l’indemnité à la date à laquelle il statue [44].
En effet, la victime ne doit pas tarder à déclarer le préjudice, le juge ne réparant que les dommages directs, et non les dommages indirects.
En outre, la justice administrative accepte dorénavant d’indemniser la souffrance physique [45], ainsi que la souffrance morale causée par la perte d’un être cher [46], alors que pendant longtemps le juge estimait que « les larmes ne se monnaient pas ».
Cependant, l’administration pourra parfois voir sa responsabilité exonérée, soit totalement soit partiellement. L’administration pourra invoquer, dans le cadre de la responsabilité sans faute, la faute de la victime, car « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » [47], ou la force majeure [48], tandis que dans le cadre de la responsabilité pour faute elle pourra également invoquer la faute d’un tiers [49], ou le cas fortuit [50].
Ainsi, il est donc indéniable que la justice administrative, au cours des années, voire des siècles, a acquis de nombreux pouvoirs qui lui permettent de garantir au mieux aux citoyens le respect des exigences de l’État de droit par l’administration.
Marie Fernandez
Master 1 Droit international et européen 2011-2012
Université Pierre Mendès France, Grenoble II
|
Notes
[1] La première astreinte fut prononcée dans l’arrêt CE 1985 Mme Menneret
[2] CE 1954 Barel
[3] CE 1970 Amoros
[4] CE 2002 Front national
[5] CE 2005 Campoloro
[6] CE 1905 Martin
[7] CE 1978 Ville de Lisieux
[8] CE 1996 Cayzeele
[9] CE 2004 Association AC !
[10] CE 1901 Casanova
[11] CE 1950 Dame Lamotte
[12] CE 1972 Farrugia
[13] CE 1875 Pariset. CE 1924 Bogêt
[14] CE 1916 Caminot
[15] CE 1954 Barel
[16] CE 1971 Ville Nouvelle Est
[17] CE 1991 Dame Babas
[18] Principe monarchique existant sous l’Ancien Régime
[19] TC 8 février 1873 Blanco
[20] Marcel Planiol 1853-1931. Jurisconsulte et professeur de droit français.
[21] TC Pelletier 1875
[22] Edouard Laferière 1841-1901. Jurisconsulte français.
[23] CE 1973 Saoudi
[24] CE 1953 Veuve Bernadas
[25] CE 2002 Papon
[26] CE 1911 Anguet
[27] CE 1949 Demoiselle Mimeur
[28] CE 1918 Epoux Lemonnier
[29] CE 1951 Laruelle
[30] René Chapus. Professeur émérite de droit à l’université Paris II.
[31] CE 1992 Epoux V
[32] CE 1998 Améon
[33] CE 2003 Chaba
[34] CE 1895 Cames
[35] CE 1919 Regnault Desroziers
[36] CE 1966 Thouzelier
[37] CE 1990 Cofiroute
[38] CE 1946 Commune de Saint Priest La Plaine
[39] CE GIE Axa Courtage 2005
[40] CE 1923 Couitéas
[41] CE 1938 Société anonyme des produits laitiers La Fleurette
[42] CE 1966 Compagnie générale radio-électrique
[43] CE 1947 Compagnie des eaux contre Dame Pascal
[44] CE 1947 Dame Aubry
[45] CE 1958 Commune de Grigny
[46] CE 1961 Le tisserand
[47] CAA Bordeaux 2002 Société Voréal
[48] CE Commune de Val d’Isère
[49] CE 1986 Cilaos
[50] CE 1971 Département du Var, Ville de Fréjus |
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique