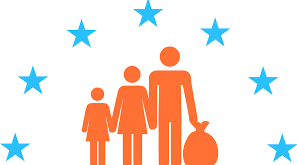Même le crime de génocide, le « crime des crimes », n’échappe pas au principe « pas de peine sans loi » garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour EDH, Grande Chambre, Vasiliauskas c. Lituanie, 20 octobre 2015).
La rétroactivité du droit est toujours chose délicate. Cela devient même illicite lorsque les dispositions que le législateur entend faire rétroagir se trouvent être des dispositions de droit pénal. L’article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) exige que l’infraction ait existé comme telle en droit au moment où elle a été commise et que celui qui l’a commise ait pu connaître les conséquences pénales de cet acte. Il en va de même pour le crime le plus abject, le plus absolu, le « crime des crimes » : le crime de génocide. Sa consécration en tant qu’interdiction relevant d’une norme impérative de droit international ne prive cependant pas les justiciables poursuivis pour la commission de tels actes, des garanties attachées au principe nullum crimen, nulla poena sine lege. La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a eu ainsi, dans une affaire récente, à se prononcer sur la condamnation d’un individu pour crime de génocide, pour des actes dont la qualification de génocide était en effet discutable à la lumière des dispositions du droit international pertinent au moment des faits.
À l’origine de cette affaire, un ancien agent des services de sécurité de la République socialiste soviétique de Lituanie, qui avait pris sa retraite en 1975, fut condamné en 2004 en Lituanie pour crime de génocide, commis en 1953 à l’encontre de partisans lituaniens entrés en résistance contre le régime soviétique après la Seconde Guerre Mondiale.
Cette condamnation en 2004 posait néanmoins une difficulté importante, dans la mesure où la définition du crime de génocide en droit international public ne semblait pas permettre de qualifier les meurtres de partisans comme un génocide, malgré le caractère collectif et l’intention politique qui ont présidé à la commission de ces meurtres par les services de sécurité. La correspondance entre la définition de ce crime et la condamnation de l’ancien agent pour la commission de celui-ci pour des faits qui n’entraient pas dans cette définition, allait poser la question d’une possible violation de l’article 7 de la CESDH, selon lequel « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
La question qui se posait devant la juridiction strasbourgeoise était ainsi celle de savoir si la condamnation du requérant correspondait à celle d’« une infraction d’après le droit national ou international » « au moment où elle a été commise », en 1953. La réponse à cette question exigeait de déterminer ce qui constituait un crime de génocide en 1953, selon la définition internationale de ce crime.
1. Le contexte historique et la procédure devant les juridictions internes
Un rappel historique tout d’abord. La Lituanie fut occupée par l’Armée rouge à partir de 1944 dans le cadre des contre-offensives soviétiques contre l’Allemagne nazie. Cette occupation donna lieu à une véritable annexion de la Lituanie par l’Union soviétique, malgré le fait que cette annexion fut considérée comme illicite par nombre d’États occidentaux. Cette annexion transforma le territoire occupé en République socialiste soviétique de Lituanie. Des mouvements de résistance contre l’occupant soviétique s’organisèrent en Lituanie, comme dans les autres pays baltes illicitement occupés. La répression à l’encontre de ces mouvements de résistance fut particulièrement violente, avec des déportations et des exécutions sommaires. C’est dans le cadre de cette répression de la résistance lituanienne qu’eurent lieu les faits pour lesquels était incriminé M. Vasiliauskas. L’occupation resta continue jusqu’à ce que la Lituanie devînt de jure indépendante de l’Union soviétique le 11 mars 1990, bien que le retrait effectif des troupes soviétiques n’eût lieu qu’en août 1991.
M. Vasiliauskas fut condamné en première instance par le tribunal régional de Kaunas pour la commission du crime de génocide du fait de sa participation au meurtre de deux partisans lituaniens le 2 janvier 1953. Le tribunal régional établit notamment que le requérant avait collaboré dès 1951 avec les services de sécurité soviétiques (MGB, qui précéda le célèbre KGB) en tant qu’agent opérationnel et qu’il était nécessairement informé du fait que la mission principale du MGB était « d’éliminer physiquement un groupe politique particulier, les partisans lituaniens, composante de la population lituanienne » (§ 31 de l’arrêt, citant et traduisant la décision de condamnation en première instance). L’ensemble des circonstances conduit le tribunal régional de Kaunas à conclure que M. Vasiliauskas avait bien participé le 2 janvier 1953 « à l’élimination physique […] de ressortissants lituaniens membres d’un groupe politique particulier […] à savoir les participants à la résistance contre l’occupant soviétique, et que [le requérant] avait ainsi pris part à un génocide » (§ 31, citant le jugement de condamnation). Deux éléments de droit interne doivent être mentionnés. D’une part, le tribunal régional se fondait sur l’article 3 de la loi du 9 avril 1992 relative à « la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne » pour justifier que de tels faits pouvaient donner lieu à des poursuites rétroactives. D’autre part, il est important de préciser que ces poursuites ne pouvaient être que rétroactives dans la mesure où, comme la Cour EDH le relève, aucune disposition de droit pénal interne applicable en Lituanie au moment des faits n’incriminait l’acte de génocide.
M. Vasiliauskas bénéficia d’une suspension de peine pour des raisons de santé, compte tenu de son âge avancé.
Le 21 septembre 2004, la Cour d’appel confirma la condamnation du requérant, jugeant la décision de première instance conforme à la loi et bien fondée en droit et en fait. À l’instar du tribunal régional, la Cour d’appel retint que le requérant, en tant qu’agent opérationnel du MGB, avait parfaitement connaissance du fait que l’objectif de celui-ci était l’élimination physique des partisans lituaniens et que c’était en pleine connaissance de cause qu’il avait pris part aux meurtres de partisans. Le requérant invoqua le moyen selon lequel la définition du génocide retenue à l’article 99 du code pénal lituanien n’était pas conforme à l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (ci-après « la Convention de 1948 »).
Ce point mérite une attention particulière. La Cour d’appel concédait que l’article 99 du code pénal lituanien, en retenant les groupes « sociaux et politiques » parmi les cibles de meurtres permettant la qualification de génocide, avait un sens plus large que la Convention de 1948 mais que ce sens plus large « était raisonnable et conforme à la réalité ». Surtout, la Cour d’appel relevait que la Convention n’interdisait pas une interprétation plus large du sens du terme génocide visé à son article II et se fondait sur les codes pénaux d’autres pays pour justifier que soit retenue une telle interprétation du terme de génocide. La Cour d’appel rejeta ce moyen.
La Cour suprême de Lituanie confirma la condamnation par un arrêt du 22 février 2005. La juridiction suprême retint principalement les mêmes motifs que la Cour d’appel pour confirmer la condamnation : la Convention de 1948 autorisait selon elle une interprétation plus large et l’efficacité et la pleine application de la Convention commandait aux autorités judiciaires lituaniennes d’élargir le champ des actes réprimés au-delà de la définition de l’article II de la Convention. Ayant épuisé les voies de recours internes lituaniennes, le requérant pouvait introduire une requête devant la Cour EDH pour contester sa condamnation par les juridictions nationales sur la base des droits garantis par la CESDH.
Dans sa requête devant la Cour EDH, le requérant soutenait qu’il avait été condamné sur le fondement de l’article 99 du nouveau code pénal lituanien, qui incrimine le génocide en incluant celui de groupes politiques – tels que les partisans – alors que les groupes politiques ne figurent pas au titre des groupes susceptibles de subir un génocide selon la Convention de 1948.
2. Les principes issus de l’article 7 CESDH et les interprétations divergentes du génocide
La Cour commence par énoncer les principes généraux relatifs au principe « pas de peine sans loi » garanti par l’article 7 de la Convention. Notamment, la Cour rappelle en premier lieu que l’objet et le but de cet article commande de l’interpréter et de l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (§153). La Cour rappelle surtout le cœur du principe contenu à l’article 7 : cet article ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal « au désavantage de l’accusé » mais exige que l’infraction soit clairement définie par le droit, national ou international. La jurisprudence de la Cour EDH permet de considérer que cette condition est remplie « lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux et d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. À cet égard, la Cour a indiqué que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité » (§155). Bien que la Cour admette qu’il y ait une part irréductible d’interprétation judiciaire, elle insiste sur l’importance d’assurer que l’interprétation judiciaire des dispositions pénales demeure prévisible afin de garantir la connaissance pour l’accusé du risque de voir sa responsabilité pénale engagée pour tel ou tel acte (§156).
Plus spécifiquement pour le crime de génocide, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à examiner la compatibilité à l’article 7 CESDH, d’une interprétation de l’infraction du génocide selon laquelle devait être retenue comme constitutive d’une telle infraction, la destruction d’unité sociale plutôt que la destruction physique d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans l’affaire Jorgic c. Allemagne (12 juillet 2007, req. n°74613/01), la Cour avait retenu que « si au moment des faits incriminés, certaines autorités (des organisations internationales, des tribunaux internes et des juridictions internationales, une partie de la doctrine et certains auteurs) défendaient l’interprétation la plus large du crime de génocide tandis que d’autres penchaient pour la plus étroite, [le requérant] pouvait raisonnablement prévoir, au besoin avec l’aide d’un juriste, que l’interprétation la plus large pourrait être retenue dans son affaire et qu’il risquait en conséquence d’être accusé et reconnu coupable de génocide » (§156).
La Cour a ainsi déjà admis dans sa jurisprudence qu’une interprétation large du crime de génocide, comprenant la destruction de groupes non visés par l’article II de la Convention de 1948, pouvait être conforme à l’article 7 CESDH dès lors qu’il était prévisible pour l’accusé que l’interprétation large serait celle retenue. Si la Cour admet que des interprétations divergentes d’une même infraction peuvent exister et être l’une comme l’autre valablement retenue selon le contexte et la date des faits, le critère fondamental pour l’appréciation d’une condamnation au regard de l’article 7 demeure toujours la prévisibilité du risque de voir sa responsabilité pénale engagée pour une telle infraction.
À la lumière des principes rappelés, la Cour résume ainsi le point qu’elle doit trancher dans le cas d’espèce : « sur le terrain de l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour doit rechercher si, au regard du droit international tel qu’il se présentait en 1953, la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire […]. À cet égard, elle doit notamment s’assurer que la condamnation du requérant pour génocide était cohérente avec la substance de cette infraction et raisonnablement prévisible par celui-ci au moment où il a participé, le 2 janvier 1953, à l’opération au cours de laquelle les deux partisans […] ont été tués » (§162).
3. Les difficultés liées au droit international coutumier
Pour savoir si l’article 7 CESDH a été respecté ou violé en l’espèce par la Lituanie par le biais de ses juridictions internes, la Cour examine s’il était prévisible en 1953 que les faits reprochés exposeraient le requérant à une telle condamnation. La Cour examine ceci en deux temps : d’abord le contenu de la Convention de 1948, puis le droit international coutumier. C’est ce dernier fondement qui pose le plus de problèmes à la Cour.
La Cour rappelle que l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ne vise que quatre types de groupes protégés, les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, et constate que cette disposition ne mentionne pas les groupes sociaux ou politiques. Le recours aux travaux préparatoires de la Convention indique en outre que les rédacteurs de celle-ci n’ont pas entendu intégrer les groupes sociaux ou politiques. La Cour parvient sur ce point à la conclusion qu’il n’existe selon elle « aucune raison convaincante de s’écarter de la définition conventionnelle du génocide adoptée en 1948, y compris en ce qui concerne la liste des quatre groupes protégés qu’elle comporte ». La Cour conforte sa conclusion en énonçant que les différents instruments internationaux dans lesquels l’infraction de génocide est définie, reprennent les mêmes éléments de définition, à l’identique parfois. La Cour considère enfin que la décision de certains États de retenir dans leur droit interne une définition du génocide intégrant l’élimination de groupes politiques, ne modifie pas l’article II de la Convention, en vertu de laquelle l’élimination de tels groupes politiques ne peut pas être qualifiée de génocide.
Une remarque d’ordre général s’impose ici. D’une part, un point fondamental est omis par la Cour dans ses motifs relatifs à l’article II de la Convention : la Convention n’était pas formellement en vigueur au moment des faits ! L’Union soviétique signa la Convention le 16 décembre 1949 et ne la ratifia que le 3 mai 1954 – soit après la date des meurtres qualifiés de génocide (qui eurent lieu, pour rappel, le 2 janvier 1953). Pour sa part, la Lituanie n’adhéra à la Convention que le 1er février 1996. La juridiction strasbourgeoise se focalise sur le contenu de la disposition définissant l’infraction mais ne se prononce pas sur ce qui constituait ici des obstacles rédhibitoires du droit des traités, notamment la non-rétroactivité des traités. La Convention était certes signée par l’URSS, mais pas ratifiée. Or, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, codificatrice du droit coutumier des traités, la seule obligation qui pèse sur un État pendant la période entre la date de la signature et celle de la ratification est celle de ne pas priver le traité de son objet et de son but (Laurence Boisson de Chazournes, Anne-Marie La Rosa et Makane Moïse Mbengue, « Article 18 » in Olivier Corten et Pierre Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, commentaire article par article, vol. I, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 589-638).
Il est certain que le respect de l’objet et du but de la Convention commandait que soient punis des actes de génocide ayant eu lieu pendant la période suivant la signature et même avant l’entrée en vigueur formelle de la Convention, dans la mesure où il aurait été manifestement contraire à l’objet et du but de ce traité de laisser impunis de tels actes. En revanche, il est étonnant que la Cour EDH n’accorde pas davantage de développements à la question de l’applicabilité de cette convention à la date des faits, alors que la prévisibilité du risque de condamnation pouvait sembler pour le moins incertaine compte tenu du statut de la Convention en URSS en 1953 : peut-on considérer comme prévisible le fait d’être condamné sur le fondement d’une convention non ratifiée au moment des faits ? La réponse devrait selon toute vraisemblance être négative à la lumière des principes issus de l’article 7 CESDH.
Néanmoins, il y a sans doute une explication simple au fait que la Cour fasse aussi peu de cas de l’absence de ratification de la Convention en URSS à l’époque des faits : la Cour savait pertinemment que la question de la prévisibilité allait se poser sur le terrain du droit international coutumier, davantage que sur le terrain du droit conventionnel.
Pour savoir si le meurtre de membres d’un groupe politique correspondait à une « infraction d’après le droit […] international » « au moment où elle était commise », la Cour EDH examine si le droit international coutumier de 1953 ne retenait pas une définition plus large du génocide que celle de la Convention de 1948. Deux éléments à cet égard doivent retenir notre attention.
D’une part, la Cour EDH établit que le droit coutumier au moment des faits interdisait bien le génocide, de la même manière que la Convention de 1948. Les juges estiment que la liste des groupes des personnes protégées selon l’article II de cette Convention reflète la coutume internationale, laquelle exclut donc clairement les groupes politiques. En réalité la Cour EDH ne discute le contenu du droit coutumier interdisant le génocide qu’à la lumière de la seule Convention. Son appréciation du droit coutumier se limite à examiner le compromis établi entre les États vainqueurs en 1948 sur la définition du génocide, laquelle a exclu formellement les groupes politiques ou sociaux. Certains auteurs soulignent d’ailleurs que ce fut l’Union soviétique qui s’opposa à ce que l’élimination de ces groupes soit qualifiée de génocide par la Convention (Josef Kunz, « Editorial Comments : the Genocide Convention », American Journal of International Law, vol. 43, 1949, p. 734).
La Cour EDH ne recherche pas le droit coutumier de l’époque à partir des critères pourtant universellement admis depuis l’affaire Plateau continental de la Mer du Nord de la Cour internationale de Justice du 20 février 1969 : une pratique uniforme et constante des Etats, et l’opinio juris de ceux-ci (le sentiment d’être liés par une règle de droit). L’absence de communications et d’informations à ce sujet rendait un tel examen difficile. La Cour recourt alors essentiellement à la doctrine pour établir le contenu de l’interdiction coutumière du génocide en 1953, y compris en se référant à des travaux ultérieurs. La Cour s’attarde assez longuement sur les différentes positions de la doctrine à ce sujet et constate les profondes divergences des publicistes sur le point de savoir si le droit international coutumier interdisant le génocide devait s’appliquer aux groupes politiques en 1953 (§§171-175). Face à ces divergences inconciliables, la Cour retient « qu’il existait à l’époque pertinente des arguments pour considérer que les groupes politiques étaient protégés en 1953 par les règles de droit international coutumier incriminant le génocide. Toutefois, elle observe que des arguments tout aussi puissants s’opposaient à cette thèse à la même époque. En l’état de ces constatations, la Cour rappelle, d’une part, que nonobstant les avis favorables à l’inclusion des groupes politiques dans la notion de génocide, la définition de ce crime codifiée par la Convention de 1948 revêt une portée plus étroite et, d’autre part, que cette définition a été reprise dans tous les instruments de droit international ultérieurs ». Dans la mesure où le droit écrit codifié et les autres traités internationaux n’ont retenu que la définition étroite excluant les groupes politiques, la Cour accorde une valeur plus importante à cette définition étroite, malgré le fait qu’elle reconnaisse le bien-fondé d’une interprétation large incluant dans la définition des groupes non mentionnés par l’article II de la Convention. Ne disposant pas d’autres fondements que ces quelques auteurs pour confirmer que la définition large s’imposait en 1953, la Cour « estime qu’il n’existe pas de base suffisamment solide pour conclure que le droit international coutumier applicable en 1953 incluait les « groupes politiques » parmi ceux relevant de la définition du génocide » (§175).
La Cour EDH considère que le droit coutumier au moment des faits interdisait bien le génocide, mais dans les mêmes termes que la Convention de 1948. La coutume internationale relative à l’interdiction du génocide ne comprenait donc pas, en 1953, l’élimination des groupes politiques.
La Cour EDH souligne ainsi que, si les juridictions lituaniennes pouvaient retenir une interprétation plus large que la définition du génocide donnée à l’article II, ceci ne les autorisait cependant pas à prononcer des condamnations rétroactives.
4. Le constat de violation et les conséquences de l’arrêt
À partir de ces éléments, la condamnation du requérant par les juridictions lituaniennes pour un acte qui ne constituait pas, au moment il a été commis, une telle infraction en vertu du droit international ne pouvait conduire qu’au constat de violation. La Cour conclut ainsi à la violation de l’article 7 § 1 CESDH par la Lituanie (§ 191).
À la différence d’autres droits issus de la CESDH, l’article 7 ne peut pas faire l’objet de limitations de la part des autorités de la Haute Partie Contractante. La Cour examine tout de même si la condamnation de M. Vasiliauskas ne pouvait pas être justifiée par l’article 7 § 2, dans la mesure où le Gouvernement lituanien avançait que les actes en cause étaient considérés comme « criminels » à la date des faits. L’article 7 § 2 CESDH dispose que l’article 7 § 1 « ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». La Cour rappelle que l’article 7 § 2 n’offre pas une exception au principe de non-rétroactivité, mais elle conclut rapidement que cette disposition ne saurait justifier la condamnation pour génocide de 2004. Trop rapidement selon nous, dans la mesure où elle se contente à cet égard de rappeler sa jurisprudence relative à l’article 7 § 2 mais sans expliciter les raisons de son refus.
Dans l’affaire Kononov c. Lettonie (17 mai 2010, req. n°36376/04), en se référant aux travaux préparatoires de la CESDH, la Cour avait établi que cette disposition ne visait en réalité que les lois exceptionnelles réprimant les diverses exactions et les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre Mondiale, et ce type de lois uniquement. On comprend alors les oppositions de la Cour à reconnaître la condamnation de M. Vasiliauskas fondée sur le caractère « criminel » des actes au sens de l’article 7 § 2, dans la mesure où, conformément à sa jurisprudence Kononov, les lois pénales lituaniennes incriminant le génocide ne visaient pas à réprimer des actes d’une exceptionnelle gravité survenus pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Il est cependant regrettable que la Cour EDH n’ait pas saisi l’opportunité de modifier sa jurisprudence relative à l’article 7 § 2. En effet, l’élimination systématique de résistants dans le cadre d’une annexion illicite pouvait raisonnablement relever d’un crime d’après les principes des nations civilisées, et ce dès 1953. La Cour aurait pu davantage prendre en compte les éléments de contexte graves pour admettre que les jugements et punitions du paragraphe 2 de l’article 7 devaient avoir vocation à s’appliquer dans d’autres cas que ceux survenus pendant la Seconde Guerre Mondiale : en l’espèce, l’occupation et l’annexion illicites de la Lituanie ; la répression systématique et implacable des contestations et des minorités nationales par le biais d’exécutions extrajudiciaires; et l’impossibilité totale d’organiser de telles poursuites pénales avant la fin de l’annexion soviétique en 1991. L’article 7 § 2 nous semble trop restreint dans son champ matériel et temporel en l’état actuel de la jurisprudence.
La décision n’a pas manqué de faire réagir la doctrine. Étonnamment les critiques envers la décision sont nombreuses, ces critiques se focalisant principalement sur le fait que la Cour ait retenu une approche stricte de la définition du crime de génocide. Notamment, il est reproché à la Cour d’avoir manqué de pragmatisme et d’avoir donné un poids trop important à la définition « arbitraire » du génocide figurant à l’article II et de ne pas s’être fondée sur les évolutions ultérieures de la définition issues de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux (Marko Milanovic, « European Court Tackles the Definition of Genocide », EJIL: Talk!, 27 octobre 2015).
Ces critiques peuvent regretter l’absence de proposition nouvelle de la part de la Cour mais on ne saurait remettre en question la logique de la Cour, à la fois au regard de l’examen de la définition du crime en 1953 et au regard de sa propre jurisprudence sur la prévisibilité des risques pénaux de la commission d’une infraction au sens de l’article 7 CESDH. On comprend la volonté de certains auteurs de voir la Cour marquer d’une particulière infamie le crime de génocide, quitte pour cela à devoir opérer un revirement de jurisprudence, mais une telle proposition reviendrait à qualifier de génocide des faits qui échappaient au moment des faits à cette qualification, et y échappent peut-être aujourd’hui encore, simplement pour les reconnaître comme tel.
Si certains s’attristent du classicisme et de l’orthodoxie de la décision, il faut admettre qu’une prise en compte plus relative dans le temps de la définition du contenu d’infractions pénales, aussi graves soient-elles, conduirait à des remises en cause importantes du principe d’interdiction de la rétroactivité du droit pénal garanti par l’article 7 § 1 CESDH.
L’arrêt s’intègre dans une dynamique récente de la jurisprudence internationale favorisant une définition classique du crime de génocide, et montre la pleine participation de la Cour EDH à cette dynamique par ses lectures conciliées des principes du droit international général et des droits fondamentaux. Il est clair que cette décision constituera un élément important des complexes débats doctrinaux autour de la définition du crime de génocide à travers le temps. Si la Cour admet une interprétation évolutive du contenu de l’infraction selon la date des faits, l’arrêt doit être salué dans la mesure où il vient rappeler qu’une telle interprétation évolutive ne doit jamais se faire au détriment des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Arnaud LOBRY
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique